Avant la sortie de Blade Runner, Philip K. Dick faisait déjà rêver le cinéma. Seulement comment s’emparer de l’auteur de science fiction le plus conceptuel ? Comment traduire en images l’homme du temps non linéaire, des réalités multiples, des visions psychédéliques basculant dans une métaphysique aussi bordélique que géniale ? À ces questions, tous ceux qui ont voulu adapter son oeuvre, et en particulier Ubik (dont l’auteur signait lui-même un scénario à la demande de Jean-Pierre Gorin en 1974), se sont souvent cassés les dents. Il a fallu attendre Ridley Scott avec Blade Runner (adoubé in extremis par Dick et échec commercial en salles) pour que le cinéma s’empare timidement d’une œuvre foisonnante à laquelle seuls quelques films sauront vraiment se mesurer ensuite (Total Recall, Minority Report, Scanner Darkly).
Si Ubik est promis à rester dans les cartons (Gondry a récemment jeté l’éponge), Le Maitre du haut château, best seller dickien et roman emblématique, a enfin son adaptation, étrangement très tardive compte tenu de son succès en librairie. Plus d’un demi-siècle après sa parution, cette bible des récits uchroniques, imaginant un monde où l’axe du mal a gagné la guerre (Hitler a survécu, les États-Unis sont occupés par le Reich et l’Empire Nippon), a trouvé refuge chez Amazon, pour une transposition feuilletonesque soutenue par Ridley Scott et conçue par Franck Spotniz, longtemps proche de Chris Carter.
Avec dix épisodes qui ouvrent sur une très probable seconde saison, The Man in the High Castle entend bien tirer un bénéfice maximum de son matériau d’origine. Roman qu’il adapte et donc qu’il manipule, transforme, pour lequel il invente des personnages, modifie des éléments, étire d’autres, bref dont il fait un autre format, et tant mieux. Ou pas. La série décolle péniblement, le démarrage est lent, engoncé, et le casting sans relief comme les décors patinés ont du mal à donner vie aux trajectoires entrecroisées de ces personnages qui, tous (espion nazi, officier SS américain, chef du Kempeitai, ministre japonais, ouvrier juif, fille paumée, résistants…), sont embarqués dans une obscure histoire de films que chacun cherche à récupérer.
Ces films étaient chez Dick un roman (dont l’auteur serait ce mystérieux maitre du haut château). Adaptation oblige, la série va chercher dans le cinéma un médium plus conforme à son support pour ce qui est, à l’origine, le grand alibi théorique de l’oeuvre. Car que contiennent ces bobines ? Le futur, ou plutôt des réalités alternatives, supposées interroger les personnages (et le lecteur) sur le monde dans lequel ils vivent : celui de 1962, où Hitler est vieillissant, et où des hommes du Reich complotent contre les Japonais pour relancer la guerre. Si cette variation n’enlève rien aux réflexions de Dick sur la perception de la réalité (et va jusqu’à les rapprocher du cinéma, ce qui poétiquement fait sens en plus de renvoyer à la fascination d’Hitler pour les films), la série ne sait trop comment infuser cette pépite de réflexivité dans son récit. Plus ennuyeux encore, elle peine à donner une pertinence pour aujourd’hui à cette lecture inversée de l’histoire.
Première contrainte : comment dépeindre ce monde alternatif ? À la fois artificielle et détaillée, la série tente de créer un monde vraisemblable baignant dans une atmosphère quasi onirique. Un joli parti pris, mais dont le traitement renvoie la série à une reconstitution stylisée, pas quelque chose qui aurait l’audace théorique de se présenter comme une réalité en soi (c’était aussi l’objectif dickien, créer des personnages qui deviennent conscient de vivre une fiction). Ainsi, outre cette direction artistique dont l’imagerie rétro parasite parfois l’image d’un monde plausible, les films renvoient aux contraintes techniques de leur époque (des bobines en noir et blanc au filmage amateur), et non à une représentation de la réalité telle qu’elle est montrée dans le supposé réel où vivent les personnages. Sans doute la série aurait gagné en étrangeté si elle avait opté pour des films au format similaire (couleur, panoramique, etc.), quitte à mentionner cette anomalie quelque part pour ne pas faire hurler le geek de base auquel semble s’adresser la première partie du show.
Car c’est un peu sa difficulté, il faut du temps pour que The Man of the High Castle échappe au petit tour de force uchronique et à la sidération des vilaines croix gammées au sommet des buildings new-yorkais. La première partie, à force de s’appuyer sur son décor et des personnages assujettis à des trajectoires qui mettent du temps à s’épaissir, ne fait que délayer et retarder le coeur de l’intrigue, ce moment où le format (de la série) prend enfin son envol. Il faut ainsi attendre le cinquième épisode pour qu’enfin les noeuds du récit se tissent, et surtout que chaque personnage soit confronté au monde qui l’entoure, par-delà les grands fils narratifs à tricoter. Ce virage arrive inévitablement par le passage obligé de la famille et des relations : c’est cet officier SS américain (Rufus Sewell, qui vole le show à lui seul) confronté à des difficultés avec son fils ; ce ministre du commerce Japonais en fonction sur la côte Ouest traumatisé par la mort de son épouse ; ce membre du Reich remettant en cause les actions de son parti (et donc de l’Histoire) rêvant de revoir ses enfants ; cet ouvrier juif dont la soeur et les neveux sont tués par les japonais parce qu’il ne voulait pas livrer des informations sur celle qu’il aime, en fuite avec un de ces fameux films (elle-même étant embarquée dans cette aventure à cause de sa soeur disparue) ; c’est encore cet espion nazi infiltré et embarqué par affection pour un fils adoptif, alors que lui-même a un triste passé avec son père. Chaque personnage se voit ainsi relié ou rattaché à la famille, à l’autre, à ce qui donne raison de vivre et exploite les questions de l’altruisme, de l’empathie, dans un monde totalitaire. Ce n’est pas non plus un hasard si la série trouve son point d’orgue lors d’une réunion de famille.
En virant ainsi vers le soap, The Man in the High Castle commence à traiter concrètement du monde dans lequel nous aurions pu basculer. Il gomme, un peu, la trop grande distance qui sépare historiquement de cette réalité alternative (on aurait pu imaginer adaptation plus radicale dans un contexte différent), pour toucher à une universalité donnant plus de corps aux enjeux. Il permet surtout de créer un monde où se serait installé une forme de « nazisme ordinaire », une réalité où chacun vivrait sous la coupe idéologique et quotidienne du Reich et de l’Empire Japonais (pas moins autoritaire). Il y a ceux qui rejettent les horreurs du passé et tentent de se révolter ; ceux qui à l’inverse les ont intégralement accepté et minimise (le temps est passé, les camps, c’est loin) ; ceux qui deviennent perméable à la culture de l’autre (occupant ou occupé) et atténuent ainsi les réflexes de diabolisation (tel ce collectionneur japonais fasciné par l’Amérique, une drôle d’ironie au regard de la réalité). La mise à distance de l’Histoire vécue par les personnages tord notre vision historique et morale des évènements, allant jusqu’à créer quelques scènes troublantes où le film en costume bascule alors dans cette réalité alternative derrière laquelle il court. Pas de quoi faire oublier ce léger manque de souffle, de consistance et de vision sur le long terme, mais c’est assez pour donner envie de voir jusqu’où la série mènera ce monde qui n’est, après-tout, pas toujours si éloigné du notre.








































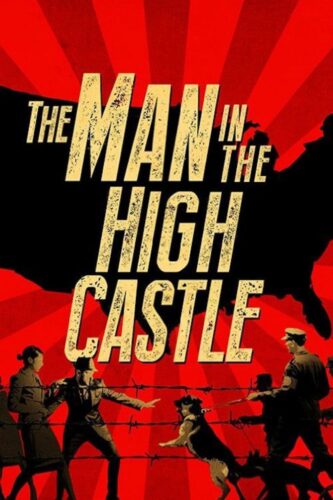





Comme ça saoule sans « les tops et les flops » de l’année de chaque catégories! Obligé d’attendre le H-S de l’année des inrocks pour être sûr de ne pas se gaufrer pour choisir sa petite série déjà si chronophage par essence!
ça arrive :)