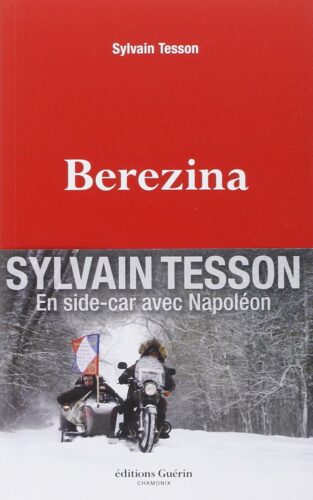À certaines (nombreuses) exceptions près, il n’y a rien de plus ennuyeux qu’un écrivain-voyageur, rien de plus rébarbatif que ces auteurs forcés d’enchaîner les kilomètres pour parvenir à pousser une ligne, rien de plus tristement fastidieux que ces prétendus poètes contraints d’emprunter des avions pour voyager alors que, comme le préconisait Céline, il suffit de fermer les yeux. Mais il y a, au sein de cette caste, des admirables, qui ne compensent pas le défaut de rêve mais le défaut de réalité du rêve, qui tiennent à éprouver celui-ci jusqu’à s’en cramer les pupilles et les nerfs. Sylvain Tesson est de ceux-là. « Un vrai voyage, c’est quoi ? – Une folie qui nous obsède, dis-je, nous emporte dans le mythe ; une dérive, un délire quoi, traversé d’Histoire, de géographie, irrigué de vodka, une glissade à la Kerouac, un truc qui nous laissera pantelants, le soir, en larmes sur le bord d’un fossé. Dans la fièvre… »
200 ans après la retraite de Russie et la déroute de la Grande Armée, Tesson, accompagné de quatre amis (deux Français et deux Russes) montés sur des side-cars soviétiques, drapeaux impériaux en proue, bicorne et shakos coiffés aux étapes, mémoires d’officiers ou de soldats médités dans les veillées, entreprend en décembre 2012 un pèlerinage sur les traces d’une débandade grandiose, et en tire son récit propre : Berezina. Chaque chapitre couvre une étape, et chaque étape permet à l’écrivain de mêler dans un équilibre parfait anecdotes du voyage, rappels historiques, méditations et délires divers, suscités par cette double trajectoire géographique et temporelle. Comparant leurs souffrances à celles, incommensurables, des soldats de Napoléon, nos motards grelottant refusent de geindre. Ces souffrances, d’ailleurs, semblent approuvées comme nécessaires, pour créer une sympathie, au sens premier, pour convoquer les fantômes, communier a minima, effleurer par les sens ce que l’esprit tente de percer et le cœur de rejoindre. Et c’est ainsi qu’à travers son périple, Sylvain Tesson se fait intercesseur entre le lecteur et la Grande Armée, la geste qu’il mène devenant l’opération qui autorise le transfert, et qui rend possibles des aperçus sur une équipée si lointaine, si terrible, si invraisemblable. Et, de nos jours, largement incompréhensible, ce pourquoi Tesson s’interroge à plusieurs reprises sur ce hiatus entre les mentalités, et sur l’incapacité qui serait la nôtre à subir ce que subirent les Grognards et, à la fois, à rêver et accomplir ce qu’ils rêvèrent et accomplirent.
Par son rythme, son allant, son élégante désinvolture, son sens aigu de la formule, Tesson, littérairement, rappelle les Hussards, tout en évoquant les Grognards. Métaphores efficaces, répliques tranchantes et allure débridée se conjuguent au sein d’une sorte de grand brouillard mélancolique, dont la beauté tient autant à la dimension résolument tragique de l’Histoire qu’au regret d’en être sorti, d’avoir abandonné l’épopée collective pour l’individualisme consumériste, et de ne pouvoir que la commémorer avec le maximum de panache. Derrière le défi, un rien potache, c’est tout de même ce genre de questions qui sont posées, entre deux escales noyées de vodka. De ceux qui souffrirent anonymes sous les assauts des Cosaques et du Général Hiver, ou de nous qui bâfrons sans idéal dans une insignifiance confortable, qui sont les plus spectres ?
Sylvain Tesson sera, le jeudi 19 mars, l’invité du Cercle cosaque.