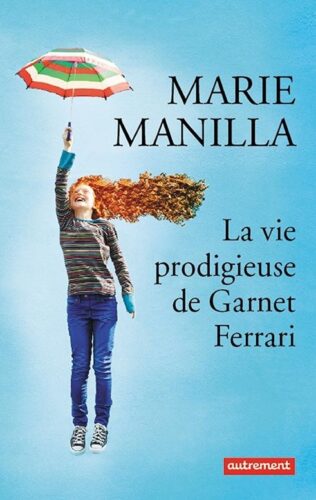Un grand n’importe quoi jubilatoire : Marie Manilla enrichit l’iconographie chrétienne avec les traits d’une improbable jeune femme, née avec la carte du monde dessinée sur le tout corps par amas de taches de vin, incapable de se rendre figure humaine mais à même, par contre, de soigner tous les grands et petits maux dermato de l’humanité. Parfois. Parce que c’est ça, le don de Garnet Ferrari : guérir, mais pas tout le temps. La sainte de Sweetwater, adulée par sa ville puis par des pèlerins du monde entier, se doute bien qu’il y a un truc. Elle soupçonne fortement sa Nonna de ne pas être pour rien dans ces histoires. Mais elle n’est sûre de rien, juste pas idiote. Alors, puisque le Vatican dépêche ses envoyés spéciaux, elle leur raconte sa vie, si c’est ça qu’ils veulent entendre.
Le prétexte est délicieusement original, le récit à l’avenant. La vie de Garnet, c’est un peu une biographie de Bernadette Soubirous version pop. Outre le lot convenu de miracles (verrues qui tombent, poireaux qui s’estompent, taches et eczémas en tous genres qui s’effacent…), il y a dans cette vie prodigieuses des sirènes (version femmes-poissons), des siciliens réacs au machisme vieille école, des femmes plus ou moins à poigne, des atlas, des amulettes maison. Et si c’est un peu lent au démarrage, à l’arrivée, on a ri. Le truc de Manilla, c’est la caricature jusqu’au-boutiste : si on pense qu’elle est allée loin, elle en fait un peu plus. Elle pousse toutes ses descriptions, tous ses personnages, toutes ses histoires dans l’histoire jusqu’à leur point de rupture – allant jusqu’à en rire elle-même si nécessaire.
On la suit donc de la Sicile à Sweetwater, Virginie occidentale, « coincé comme Berlin-Ouest en Allemagne de l’Est, refuge papal pour les cathos sans Checkpoint Charlie et le Mur de Berlin », abritant face à face une colonie d’Italiens, une autre d’Irlandais – ambiance à l’heure de la messe, gérée par le père Luigi O’Malley, « prêtre hybride ». La vie de Garnet oscille entre Dickens et Austen, misères ordinaires, indigence et sens de la destinée (après tout, Maman a des ancêtres tout droit descendus du Mayflower). Le tout avec force rebondissements burlesques, pour peindre une enfance et une adolescence somme toute (presque) ordinaires. La réussite du roman est de nous emmener au bout, sans concession : Manilla écrit une langue colorée d’italien qui n’a pas trop fait d’efforts, pour un récit brut de décoffrage, à prendre tel quel. C’est rafraîchissant et, si ça cafouille un peu à la fin, l’ensemble reste vraiment plaisant.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sabine Porte.