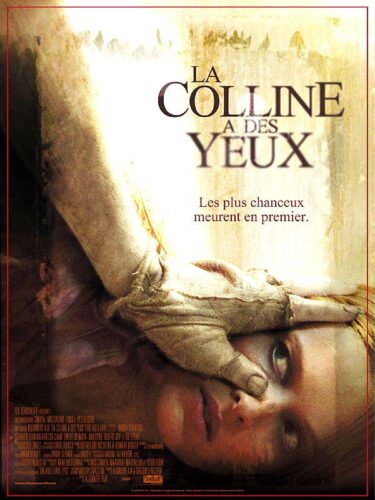Remakes des classiques du cinéma d’horreur des années 1970, suite : après L’Armée des morts, Amityville ou Massacre à la tronçonneuse, au tour de la Colline a des yeux, diamant brut du survival signé Wes Craven (1977), de passer en revue. Enorme surprise, puisqu’Alexandre Aja fait ici coup double, signant non seulement la meilleure réussite de cette vague un peu dégénérée de remakes, mais s’imposant surtout – et de très loin – comme le seul exemple viable de transfert de jeunes cinéastes français dans le petit bain hollywoodien, celui de la série B. D’où un tel miracle là où d’autres avant lui ont surtout brillé par le ridicule (Siri, Gans) ou, tout au mieux, une humilité confinant à l’invisibilité (Richet, Kassovitz) ? De ce que, probablement, Aja a su exprimer dès son second film, Haute Tension, un style aussi sobre que puissant, aussi singulier que modeste dans sa manière de rendre à ses amours cinéphages -cinéma de la peur pliant le spectateur à ses mécanismes les plus primaires et viscéraux- une forme d’hommage impoli, frontal et sans complexes. Dans ce registre, inutile de préciser que le film original de Craven, récit d’une famille d’Américains républicains se retrouvant traquée par une horde de dégénérés cannibales dans le désert du Nevada, fait figure de référence absolue.
L’absence de complexes, voilà peut-être la clé de cette réussite. Il y a chez Aja une simplicité et un plaisir du défi qui imposent immédiatement leur marque. Le jeune cinéaste n’a rien changé à ses habitudes malgré la pression évidente de Craven, producteur du film, et les enjeux forcément vertigineux de ce passage outre-Atlantique. Le concept, s’il peut paraître simpliste, de la focalisation unique (prendre des personnages et les secouer comme un milk-shake jusqu’à les faire rendre gorge) ramène directement à l’âge d’or de cette horreur américaine qui gicla sur les écrans des années 1970 dans un élan sans retour. Nul gain, nulle perte dans le passage de Haute Tension à La Colline a des yeux : y demeure la même obsession, dans le découpage et la mise en scène, à rester du côté du point de vue de la victime assaillie ou traquée, à recourir à la plus extrême sobriété pour rester au plus près des personnages, dans un grand manège asséché usant jusqu’à plus soif des figures imposées du genre.
Dès l’ouverture, Aja impose ce rythme syncopé et ultraviolent du film d’origine pour lancer le récit sur les chapeaux de roue. Cette volonté de choquer est évidente, et si elle ne relève pas d’une grande finesse malgré la volonté de prolonger les enjeux du film original (la satire post-atomique qui servait de toile de fond à Craven est ici beaucoup plus marquée), elle permet à Aja de tenir son film de bout en bout et d’en marquer les principes d’identification au fer rouge. Ainsi réduit en survival pur et dur, absolument manichéen et sans une once de psychologisme, La Colline a des yeux tranche par sa belle assurance à éprouver, violenter et malmener le spectateur dans un mouvement ininterrompu.
Ici le film de Craven n’est plus qu’une ombre, une sorte de carcasse évidée qu’on tente de rechargée par à-coups. Ce reloading permanent ouvre une nouvelle dimension, un clignotement onirique proche du conte ou de la fable. Elle tend vers une forme de grandeur épique parfois un peu ronflante, mais qui recentre le film dans un cadre plus large et tente de ramener à l’histoire du survival et à son rapport à l’Ouest américain (la manière de filmer en cinémascope le désert californien, assez majestueuse). Rien que pour cette belle intuition, équilibre entre brutalité des origines et velours du mythe, Aja accomplit une trajectoire singulière qui le place parmi les plus prometteurs petits maîtres du cinéma de terreur contemporain.