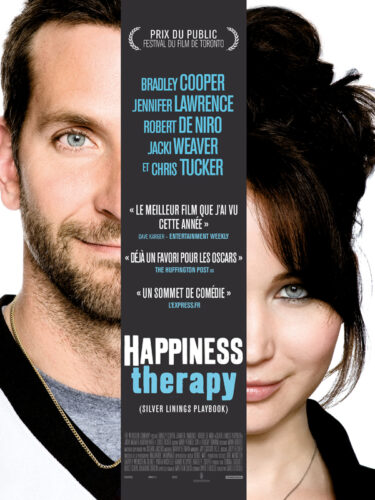Réalisateur de J’adore Huckabees et de l’excellent Fighter, David O. Russell s’essaye au quirky movie : la comédie romantique entre deux êtres dépressifs et un peu bizarres qui décident de partager une bulle à deux. L’exercice est redoutable, tant il a l’habitude de charrier son pesant de chansons pop sucrées et de cimetières d’animaux domestiques – cf. Juno, Garden State et consorts, mais aussi l’exercice plus radical et à peine supportable du dernier Gus Van Sant, Restless. Dès ses premiers plans, Happiness Therapy se lance à corps perdu dans cette romance entre deux êtres pas comme les autres et ballotés par la vie. Tout est là, à sa place : le petit jogging du retour à la vie, l’image désaturée, la pop-berceuse, le couple d’amis normaux. Ne manque plus que l’ami invisible et des nuages en forme d’animaux.
Mais Happiness Therapy gagne en aplomb à force d’avancer, et finit par ne plus être si déchiffrable que ça : sous ses atours de petit cupcake tout périmé, le film se révèle être une sorte de version moins radicale de J’adore Huckabees. La recette est la même : une morale du self-improvment un peu bourrine où le monde se partage entre les pessimistes et les optimistes, ici coulée dans le moule de l’amourette en sweat-shirt. Dans Huckabees, cela donnait la très belle idée du détective existentiel, sorte d’entité brute extirpée des entrailles du feel good movie et porté à hauteur de personnage conceptuel. Si dans Huckabees tout le squelette conceptuel donnait le sentiment d’affleurer à la surface, c’est le procédé inverse qui guide Happiness Therapy. Tout replonge, emprunte la forme la plus lisible, la plus conventionnelle. Ce qui s’atténue sans se perdre, c’est l’impétuosité de la mise en scène d’O’Russell, par moment très appuyée, à la façon d’un clippeur qui se mettrait au cinéma. Huckabees donnait l’impression d’être le résultat d’un brainstorming filmé par Spike Jonze, une sorte de cathédrale scénaristique qui finissait par s’effondrer sur elle-même. Ce qui manquait, c’est quelque chose pour faire la jointure entre deux bonnes idées.
A l’inverse, dans Happiness Therapy, ce volontarisme de clippeur réhausse complètement le film, parce qu’il prend place dans un canevas ultra-conventionnel qu’il finit par apprivoiser. Le film trouble justement par cette alternance entre ce qu’on a l’habitude de voir et ce qu’on n’avait encore jamais vu, par quelques scènes malades et informes, purement gratuites, comme ces répétitions de danse jouées à l’ombre d’un extrait de Singing in the rain. La pente clipesque d’O. Russell porte ainsi à elle seule la réussite de la dernière partie du film, transformant les tics en solutions, dénouant et libérant la mise en scène par d’amples travelling qui pénètrent une série de lieux et de nappes musicales. La grande justesse de cette deuxième partie réside aussi dans le souci très méticuleux de n’offrir à ses anti-héros que ce que la vraisemblance nous permet de leur accorder. C’est par exemple cette très belle scène de danse, étrangement filmée comme depuis le point de vue d’un troisième corps. Le score des deux partenaires fait l’objet d’un pari, et quand le score tombe il est passable quoique suffisant pour gagner le pari, mais la salle ne comprend pas les cris de joie qui viennent sacrer un score aussi nul. En une scène, l’idée de deux réalités distinctes. L’une qui note sur dix, l’autre qui se suffit de la moyenne : le quirky movie. C’est par sa façon de suggérer à plusieurs reprises cette réussite et ce bonheur à la mesure de ces personnages, d’être plus conséquent qu’aucune autre avec l’idée de romance malade, que David O. Russell précise son geste, relance les dés, détourne les règles d’un genre qui semblait aussi condamné qu’un album de reprises au ukulélé.