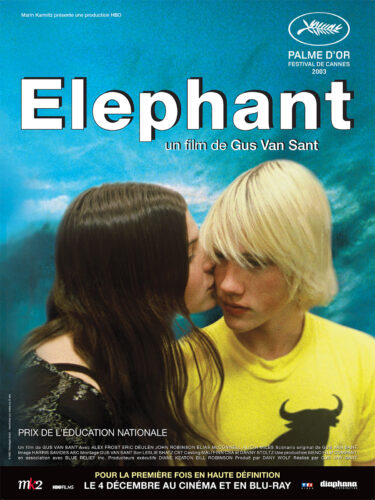Gus Van Sant est un cinéaste complexe, dont la filmographie se divise en blocs parfaitement distincts, allant du petit film indépendant, quasi underground, à la commande de studio, en passant par les plus délirantes expérimentations (Psycho) ou le blockbuster intimiste et singulier (A la recherche de Forrester). L’ère d’épure et d’abstraction ouverte par Gerry (2002), toujours inédit chez nous, trouve dans Elephant un contrepoint saisissant : non que cette variation sur le massacre de Columbine ne joue sur les mêmes effets de radicalité, mais avec cette fois une dimension documentaire, ancrée dans un réel parfaitement assigné (le petit univers du lycée et ses environs) qu’aucune mise à distance théorique ne vient troubler. De cette croisée des chemins -exercice expérimental et description ultra-réaliste-, GVS se tire une fois de plus avec une indécente réussite.
Elephant, sous des dehors de chronique étudiante polyphonique (différents personnages pris à un moment x ou y d’une banale journée de cours), tisse progressivement un espace resserré, organisé et tendu comme une toile d’araignée parfaitement géométrique. Chaque moment volé par le cinéaste (dans le parc, à la cantine, le long des couloirs, dans les salles de réunion, au gymnase) semble autonome et s’étire dans un flottement suave et envoûtant. Rapidement pourtant, les uns et les autres de ces instants se font complémentaires, correspondent entre eux ou se rejoignent en tendant à éliminer toute béance dans l’espace-temps parfaitement ordonné du lycée. Derrière les trajectoires aléatoires de chacun se découvre alors un univers commun, traversé d’un indicible sentiment de malaise (la chorégraphie froide des solitudes), dans lequel rien, en apparence, ne doit venir troubler la fluidité. Cette fluidité, rendue par l’extrême légèreté du filmage, tout en mouvements et vagabondages musiciens, est précisément ce par quoi tout finit par se détraquer : GVS n’explicite aucune origine plausible au surgissement de l’horreur, mais la définit comme un simple bug inexpliqué du système, redoublement d’un temps sur un autre (l’effet de télescopage temporel produit par les points de vue multiples et décalés qui se croisent) ou pure trouée d’une fiction devenue folle (la fine présence du jeu vidéo et de la télé comme éléments fantomatiques).
Nul n’a filmé avec tant de douceur un lycée : à la fois espace de vie et de communications intermittentes, de solitude et de refoulement, cocon d’une indécidable liberté et tombeau de toutes les frustrations (les complexes de la binoclarde dans la salle de sport), le campus d’Elephant est un espace tout à la fois intra-utérin et cosmique (le plan magnifique de tombée de la nuit), qui recouvre le champ des émotions adolescentes jusque dans ses plus délicates nuances. Plutôt que de chercher une hypothétique source au torrent d’épouvante qui recouvre la fin du film, GVS se contente de peindre en mouvement, dans un geste pudique, impressionniste et profondément subjectif, veiné d’une intarissable compassion, la vie et la mort d’une poignée d’adolescents sans relief, dans toute leur anodine et bouleversante liberté.