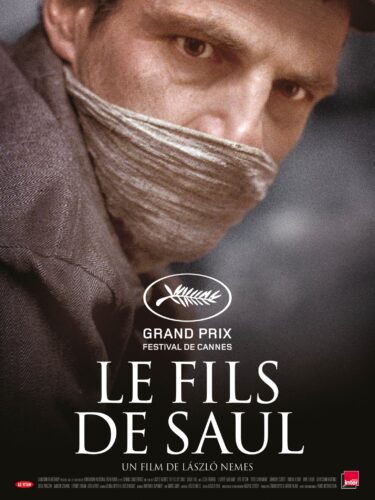Saul est Sonderkommando à Auschwitz-Birkenau: prisonnier intégré au fonctionnement du camp, il est condamné à gérer l’arrivée massive et perpétuelle des déportés, qu’il accompagne des wagons jusqu’aux chambres à gaz. Cette besogne de mort se trouve bouleversée le jour où Saul croit reconnaître le corps de son fils parmi les cadavres, et se met en tête de lui offrir une sépulture.
Sur le terrain épineux de la représentation de la Solution Finale, le personnage de Saul constitue une porte d’entrée à la fois ingénieuse et hypocrite. Ingénieuse parce que, littéralement noyé dans l’horreur, le film se refuse à une posture d’observateur solennel et pétrifié. Ici, contrairement à La Liste de Schindler de Spielberg, personne pour écarquiller les yeux face à la découverte de l’abomination : Saul est un mort-vivant que le contact prolongé et pragmatique avec la machinerie exterminatrice a rendu insensible, presque aveugle à celle-ci. Hypocrite parce que, reconstituant l’enfer tout en faisant semblant de ne pas s’y intéresser, la mise en scène relègue en périphérie ce qui s’impose pourtant d’emblée au spectateur : sous couvert de suivre son personnage dans sa quête, son programme consiste bel et bien à exposer (en flou, en arrière-plan, mais en un inventaire quasi exhaustif) les différentes étapes de la disparition des vivants, avalés par le trou noir concentrationnaire.
C’est que le fonctionnement du camp a beau se réduire à des mirages et un vacarme indistincts, on ne voit et on n’entend évidemment que ça. Surtout, on sent bien que cette atténuation surlignée est autant une pudeur qu’une ruse formelle, redoublée par une posture de défense un peu commode — façon : “J’ai procédé ainsi parce que tout le reste aurait été indécent”. Cette manière de brusquer le spectateur tout en montrant patte blanche, de braver les interdits tout en signalant que la leçon est comprise (la séquence des photos clandestines, qui semble directement empruntée au Images malgré tout de Didi-Huberman), on ne peut en vérité la reprocher qu’à moitié au film, celle-ci s’exprimant davantage dans ses à-côtés médiatiques, au fil d’entretiens avec le réalisateur où se lit en creux la fierté d’avoir su se montrer moralement digne face à son sujet.
Mais alors que Laszlo Nemes croit avoir trouvé le meilleur point de vue possible, on comprend très vite qu’il ne s’est trouvé qu’un dispositif garde-fou (le film à la première personne), derrière lequel la mise en scène peut subtilement multiplier les effets de distance esthétique (je filme autre chose que l’infilmable) et symbolique (je raconte autre chose que l’inracontable). Faisant montre d’un tempérament aussi téméraire (la première séquence fonce tête baissée en direction d’une chambre à gaz…) que précautionneux (… elle s’arrêtera juste devant ses portes), Nemes fait cohabiter deux films sans jamais parvenir à les réconcilier : l’un, immersif, est une plongée crue et sensorielle dans l’abattoir nazi ; l’autre, allégorique, est une sorte de conte teinté de religieux et d’absurde, où un homme tente de rendre à la mort sa dignité au coeur de l’Holocauste. Faute de parvenir à élever sa mise en scène (agitée mais sommaire) à hauteur de son impressionnant travail de reconstitution, Nemes condamne son beau sujet à n’être qu’un prétexte : une prière inaudible, sans cesse submergée par la sidération un peu coupable de son décor et de son dispositif, hantés par les travellings interdits et les prescriptions lanzmaniennes. Reste un incroyable personnage, rouage à la fois apathique et nerveux, fondu dans l’horlogerie concentrationnaire comme un reptile dans une jungle opaque.
Rivé à ce visage où plus aucune émotion ne passe, le spectateur est condamné à rester démuni. Trop tenté de regarder derrière l’épaule de son guide, progressivement désintéressé par sa quête, il se retrouve à négocier tout du long avec un malaise voyeuriste que le film n’assume qu’à moitié, prisonnier d’un intervalle entre les exigences de la morale et la plénitude du spectacle — entre ce que le cinéma n’aurait pas le droit de nous montrer et ce que malgré tout, on ne peut s’empêcher d’y voir.