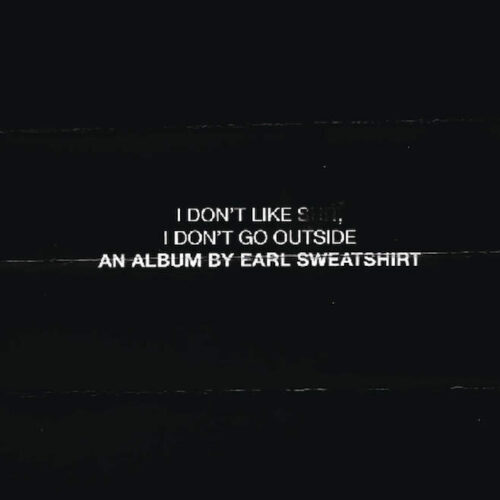Quel rappeur actuel peut se vanter d’avoir samplé le génial et excentrique Gary Wilson sur un de ses morceaux ? Repéré par Tyler The Creator il y a quelques années, Earl Sweatshirt s’est vite fait une place de choix au sein du collectif californien Odd Future – qui dynamite le rap américain depuis cinq ans d’une folie contagieuse – avec « Earl », mixtape outrageusement punk (cette vidéo pour rappel), puis un premier album impressionnant (« Doris » en 2013) dont les productions sombres et soignées et les textes vrillés et gavés de refrains inoubliables (par exemple « Nightmares got more vivid when I stopped smoking pot/And lovin’ you’s a little different, I don’t like you a lot » sur « Sunday » ou encore « I’ll fuck the freckles off your face, bitch » sur « Molasses ») l’ont catapulté comme digne successeur du génial MF Doom. C’est dire si ce deuxième album était particulièrement attendu. Mais pour le comprendre, il faut revenir sur un début de carrière complexe.
Suite à la sortie de sa première mixtape officielle, Earl (de son vrai nom Thebe Neruda Kgositsile) – fils du célèbre poète sud-africain Keorapetse Kgositsile qui l’a quitté à l’âge de 6 ans – est envoyé par sa mère – prof de droit à l’Université de Los Angeles – dans un pensionnat pour jeunes en difficulté aux îles Samoa. Rien que ça. Et pendant presque deux ans, jusqu’à ses 18 ans. Entre temps, Tyler The Creator explose dans le monde entier et hurle « Free Earl » pendant ses concerts. Des journalistes mènent l’enquête et finissent par retrouver sa trace. Leila Steinberg – mentor et première manager de 2Pac et responsable d’une association qui propose notamment des ateliers d’écriture – est chargée de nouer le dialogue avec Earl et de le ramener l’année suivante, en 2012. A son retour Earl fait du chantage auprès de ses fans sur Twitter et lâche un nouveau morceau passé le cap des 50 000 followers. Ne reniant pas des bienfaits à son exil forcé mais décidé à faire décoller sa carrière, il multiplie ensuite les collaborations et les concerts et monte son propre label, signant un accord de distribution avec Columbia. La sortie de « Doris », dont les textes très personnels abordent parfois ouvertement ses problèmes psychologiques, le révèle au grand public. Mais ce serait une erreur de croire que, deux ans plus tard, tout va mieux pour Earl.
On est frappé dès la première écoute par le minimalisme, la lenteur et la noirceur générale de « I don’t like shit, I don’t go outside » : exit les productions des Neptunes, Frank Ocean, Tyler, The Alchemist ou RZA comme sur le précédent album, randomblackdude (le pseudo d’Earl) prend les commandes de la quasi-totalité des morceaux. De même les featurings sont peu nombreux. Cette prise en main complète de l’artistique prouve d’une certaine façon qu’Earl a pris confiance en lui – et suivi les conseils de Flying Lotus qui l’avait félicité sur ses productions – mais témoigne aussi de la tonalité du disque, puissamment introspectif. C’est l’album d’un jeune homme seul, à la croisée des chemins entre sa famille et sa famille musicale, le succès et la renommée presque à portée de main, sur l’horizon.
Earl a confié qu’il a construit cet album en pensant d’abord au titre et à la pochette puis au dernier morceau – « Wool » avec son excellent compère Vince Staples – puis le premier et enfin le reste des morceaux. La construction semble en effet particulièrement travaillée : si l’intro avec son orgue acide rappelle Viktor Vaughn, les trois morceaux suivants, forment une sorte de trilogie dépressive propre à décontenancer les fans de la première heure. Chuintements d’une guitare noyée dans le delay, rythmiques en slow-mo comme un clin d’œil aux productions éthérées de SpaceGhostPurpp ou encore le « Fall in love (your funeral) » d’Erikah Badu passé aux ralentisseurs : tout cela soutient discrètement des textes où il évoque la perte de sa grand-mère, sa relation avec sa mère, une rupture amoureuse, son anxiété permanente et son grand besoin de solitude (« And I don’t know who house to call home lately / I hope my phone break, let it ring » dans « Grief ») pour régler ses problèmes personnels tout en continuant à construire sa carrière.
« Off top » est un tournant du disque, ouvrant une seconde partie musicalement moins atypique puisqu’elle partage le même sample d’Ann Peebles que le célèbre « Shadowboxin » de GZA (Wu-Tang Clan). Mais le texte poursuit dans la même veine que précédemment, évoquant cette fois son enfance et l’absence de son père. « Grown ups » sonne comme les déconstructions psychédéliques de Shabazz Palaces. Earl, dans un trip parano, se demande s’il peut encore faire confiance à ses amis ou à ces adultes qui se sont penchés sur son destin et préfère se réfugier dans la fumette ou dans l’alcool, deux addictions qui le hantent depuis plusieurs années (« Don’t know where I’m going, don’t know where I been / Never trust these hoes, can’t even trust my friends / Tell that bitch to roll up, fucking with some grown ups »). Dans la même lignée c’est avec « Inside » – point d’orgue de l’album – qu’Earl confirme qu’il veut régler ses problèmes tout seul (« Middle finger to the help / When it’s problems I don’t holler, rather fix ’em all myself / When it’s looking like it’s quiet for you this the shit to yell ») comme l’adulte qu’il est devenu, bon an mal an. L’excellent « DNA » est un duo avec son pote Nakel Smith, skater pro au flow traînant (sous acide pendant l’enregistrement, il venait en plus d’apprendre la mort d’un ami) et avec qui il a formé le groupe Hog Slaughta Boyz. Avec un final qui claque bien (« Wool »), Earl termine sur une note presque positive et prouve qu’il en a encore sous le coude.
https://www.youtube.com/watch?v=sq11Pa9IC4M
Très surprenant aux premiers abords, ce court album de trente minutes se révèle de plus en plus intéressant à chaque écoute (Earl lui-même préconise les écoutes répétées). Là où des rappeurs comme Drake tentent des introspections qui sonnent parfois faux, celles d’Earl Sweatshirt semblent taillées dans la réalité et sculptées avec dextérité par un artiste qui est en train de trouver sa voie, tout seul, à seulement 21 ans.