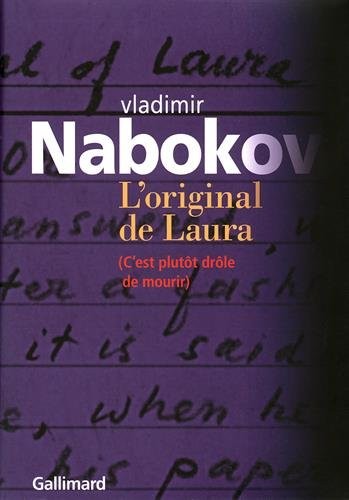Par décence à l’égard de Vladimir Nakobov, de son oeuvre sublime et du tissu indestructible de ses opinions, on aurait aimé que « l’Affaire Laura » n’ait jamais eu lieu. En fait, après l’affaire Lolita, on aurait aimé qu’il n’y ait jamais d’autre affaire associée à son nom, et qu’il ne soit désormais question que de sa littérature, ce corpus mal lu et mal connu qui est pourtant l’un des trois plus importants du siècle. Mais financièrement, les mots des grands auteurs pèsent toujours trop lourd pour demeurer dans le camp de l’art. Après des années d’hésitation cornélienne (partagée avec Véra, la femme de l’écrivain, jusqu’à sa disparition en 1991), Dmitri Nabokov, son fils, a donc décidé de trahir les instructions paternelles et de publier les 138 index cards manuscrites qui constituent L’Original de Laura, le manuscrit incomplet sur lequel son père a passé les deux dernières années de sa vie. Et plutôt que de nous empêtrer dans une purée de pois éthique qui ne devrait concerner que le fiston accablé, nous choisissons de nous réjouir de lire enfin cet inédit du Maître, même s’il faut pour cela passer outre le conseil qu’il nous glissait à l’oreille dans l’introduction de sa traduction d’Eugène Onéguine : « Les ébauches brutes, les ambiguïtés, les pistes abandonnées et les moments d’impasse de l’inspiration n’ont aucune importance en soi. Après la publication, un artiste doit brûler ses manuscrits sans hésiter, car ils trompent les universitaires médiocres à croire qu’il est possible d’y élucider les mystères du génie. En art, intention et but ne sont rien ; seul le résultat importe ».
Car quoi qu’en aurait pensé l’auteur, et dans son sillon certains critiques (dont Alexander Theroux, dont l’œuvre exigeante est l’une des rares à pouvoir se targuer d’être réellement nabokovienne), L’Original de Laura est un document passionnant, dont la lecture provoque même par intermittence un vrai bonheur littéraire. Ce qu’on entrevoit au loin par la serrure grâce à son luxueux stratagème (un écrin bien moins artificiel qu’il n’y paraît, présentant à chaque page un fac-similé de la fiche retranscrite), c’est une machinerie nabokovienne typique, une mise en abyme circulatoire où résonnent à chaque page des échos de l’œuvre passée et de la vie de l’auteur. Différents fragments convexes tombés de différents livres dans le livre racontent les accablements de Philip Wild, « Je » du livre au cœur du livre, universitaire obèse abattu par les infidélités de sa femme Flora/ Flaura, dont quelques épisodes biographiques font presque une amorce de récit. Bien sûr, le livre, à peine rédigé, ne peut même pas être qualifié d’inachevé ; certaines phrases équivoques ressemblent plus à des notes adressées à soi-même, et le recours au français dans le texte anglais évoque davantage des trous de mémoire que le trilinguisme fabuleux d’Ada – un comble pour ce magicien des jeux de langues, de genres et de niveaux de réels qu’a été Nabokov. Mais on ne cesse aussi de trébucher sur des tresses de mots magnifiques (« asperge au lieu d’aspirine »), des bons mots rogues et délicieux contre Freud ou les collègues (« Malraux, Mauriac, Maurois, Michaux, Michima [sic], Montherlant et Morand. Ce qui étonne n’est pas tant l’allitération ou l’inclusion d’un exécutant étranger ; pas même le fait que virtuellement, tous ces écrivains furent des médiocres stupéfiants… ») et de passionnantes énigmes intertextuelles. Ainsi, un personnage tripoteur de jeunes filles en fleur s’appelle Hubert H. Hubert (presque comme dans Lolita), un lieu de villégiature s’appelle Sex (presque comme dans Ada), un professeur de littérature russe pose des méchantes questions (comme Nabokov en posait lui-même à ses étudiants à Cornell)… Instables, gribouillées dans une chambre d’hôpital, ces phrases irradient quand même l’esprit du maître, dont l’œuvre et son sous-texte fabuleusement fécond de critiques, cours et correspondances nous a appris à lire et nous a souvent sauvés des philistins malfaisants qui, comme il le disait à ses élèves, veulent transformer « les Mille et une Nuits en congrès de fabricants de loukoums ».
Surtout, si Nabokov a emmené avec lui dans la tombe la signification du titre du roman, celle du sous-titre (« Dying Is Fun », pas très heureusement traduit en français par : « C’est plutôt drôle de mourir ») et celle de son accélération finale vers le néant nous hurlent presque la leur et font un commentaire troublant sur la partie manquante du texte, d’autant plus excessif qu’il est accidentel. A l’image de son héros se délectant de sa sordide auto-oblitération (il croque les coins d’un petit beurre avant de se découper les orteils), l’écrivain semble réellement goûter le jeu de miroirs en temps réel entre sa fiction et sa propre vie (on pense au destin tragique du héros de Brisure à Senestre), allant jusqu’à décrire son personnage en train de rédiger des « notes embryonnaires » dans un petit agenda. On sait que Nabokov a interrogé la mort et l’au-delà dans presque tous ses livres, mais en l’état, L’Original de Laura est un livre sur l’acte de mourir plutôt que sur la mort elle-même. Et le paradoxe métaphysique de la dernière page est aussi vertigineux que la conclusion de La Vérité sur le cas de M. Valdemar, ce conte d’Edgar Poe où un personnage s’adresse à nous depuis l’autre rivage.